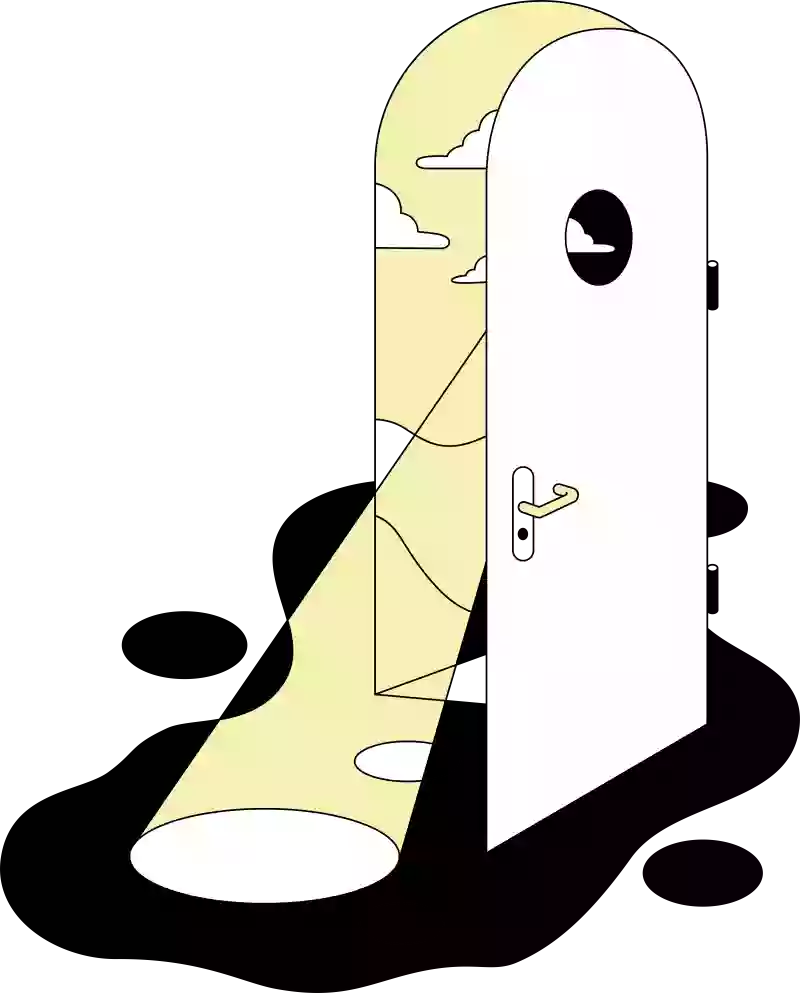
En général
Lorsqu’un travailleur ou une travailleuse se trouve dans l’inaptitude à faire son travail, quelles qu’en soient les raisons, et qu’il ou elle se met, de la sorte, en danger ou met en danger la vie de ses collègues, l’employeur doit intervenir.
L’évolution des conceptions en matière de prévention des accidents tend à mettre à la charge de l’employeur des devoirs toujours plus étendus et précis. Lorsqu’un travailleur ou une travailleuse se trouve dans l’inaptitude à faire son travail, quelles qu’en soient les raisons, et qu’il ou elle se met, de la sorte, en danger ou met en danger la vie de ses collègues, l’employeur doit intervenir.
L’évolution des conceptions en matière de prévention des accidents tend à mettre à la charge de l’employeur des devoirs toujours plus étendus et précis.
L’employeur doit tout d’abord mettre sur pied un véritable concept de sécurité qui comprendra l’analyse des risques, l’application de mesures de sécurité adéquates, ainsi que la répartition des tâches et des responsabilités en ce domaine. L’employeur doit ensuite correctement informer et instruire son personnel sur les risques auxquels il est exposé dans l’exercice de son activité et doit l’instruire sur les mesures à prendre pour les prévenir (art. 6 al. 1 OPA).
Enfin, l’employeur a le devoir de surveiller l’application scrupuleuse des mesures de sécurité afin de prévenir les accidents. Il «veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail» (art. 6 al. 3 OPA).
Si l’employeur crée un état de fait dangereux, il doit prendre toutes les mesures propres à empêcher le dommage de se produire. D’après la jurisprudence, il doit tenir compte des risques prévisibles dans la vie courante, notamment en cas d’inattention ou d’imprudence du travailleur ou de la travailleuse. L’obligation de sécurité impose donc à l’employeur la prévention de tout accident qui n’est pas dû à un comportement imprévisible et constitutif d’une faute grave de la victime (ATF 112 II 138). Si l’employeur ne respecte pas son devoir de protéger la personnalité des personnes qu’il emploie, il répondra des dommages qui en résultent sur la base de l’art. 97 CO.
Lorsque le travailleur ou la travailleuse semble incapable d’exécuter son travail sans se mettre en danger ou mettre en danger ses collègues (ex. effets engendrés par la consommation d’une substance psychoactive), l’employeur doit, en vertu de son obligation de protéger les personnes qu’il emploie, refuser la prestation de la personne concernée par un état d’ébriété.
Le travailleur ou la travailleuse doit participer aux règles de sécurité de l’entreprise. Il ou elle ne peut donc pas se mettre dans un état (consommation de substances psychoactives) exposant sa personne, ou d’autres, à un danger.
Selon l’art. 82 al. 2 LAA, «l’employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels». La collaboration des personnes employées est évidemment indispensable pour assurer la protection de leur santé. Elles sont tenues de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions en ce domaine (art. 82 al. 3 LAA). On trouve des normes similaires à l’art. 6 al. 3 LTr.
«Le travailleur est tenu de suivre les directives de l’employeur en matière de sécurité au travail et d’observer les règles de sécurité généralement reconnues» (art. 11 al. 1 OPA). Selon l’art. 11 al. 3 OPA, qui a une importance particulière dans ce contexte, un travailleur «ne doit pas se mettre dans un état tel qu’il expose sa personne ou celle d’autres travailleurs à un danger. Cela vaut en particulier pour la consommation d’alcool ou d’autres produits enivrants».
L’employeur qui laisse sciemment travailler une personne en état d’ébriété viole ses devoirs de protection de la santé.
Les exigences en matière de protection de la santé des travailleurs et des travailleuses deviennent de plus en plus importantes. Les nouvelles tendances visent à engager la responsabilité des personnes qui n’ont pas tout mis en œuvre pour prévenir la survenance d’accidents sur le lieu de travail.
Employeur
L’employeur qui laisse sciemment travailler un employé ou une employée en état d’ébriété viole gravement ses devoirs de protection de la santé. Ses responsabilités civile et pénale peuvent être engagées. Il risque même un droit de recours exceptionnel de l’assureur LAA ou une augmentation des primes.
Supérieur hiérarchique
L’implication de la responsabilité d’une personne du rang hiérarchique supérieur est moins évidente. En effet, celle-ci n’a en principe pas de relation contractuelle avec la victime de l’accident et il est difficile de lui imputer un acte illicite en cas de simple omission.
En cas de violation de ses devoirs contractuels envers son employeur, le ou la cadre peut parfois devoir réparer le dommage causé à l’employeur. Par ailleurs, en matière pénale, le ou la cadre qui n’a pas respecté sa position de garant ou garante, peut engager également sa responsabilité lorsque son inaction a favorisé l’infraction commise.
Dépistage et tests
Seuls un intérêt prépondérant en matière de sécurité et un consentement de du travailleur ou de la travailleuse peuvent justifier des tests de dépistage. Il ne suffit cependant pas qu’un test soit justifié pour être licite. Il doit en outre être le moins invasif possible et il ne peut être fait que par des personnes issues du monde médical.
La responsabilité de l’employeur face à une consommation problématique de substances d’un collaborateur ou d’une collaboratrice est importante. La consommation de substances psychotropes légales ou illégales pouvant perturber le travail n’est pas conciliable avec l’exercice d’un travail. Leurs propriétés les rendent incompatibles avec les exigences de qualité et de sécurité du monde professionnel. Ces raisons peuvent amener certaines entreprises à vouloir introduire des tests de dépistage (ex. tests d’urine).
Addiction Suisse met en garde contre une mise en œuvre de ces pratiques trop souvent inappropriées si elles ne font pas partie d’un programme de prévention visant la santé des travailleurs et des travailleuses. Elles vont à l’encontre du respect de la sphère privée et sont de nature à détériorer le climat de confiance propice au dialogue. Cela d’autant plus qu’il existe d’autres moyens moins intrusifs et plus professionnels pour intervenir en cas de doutes au sujet d’une éventuelle prise de substances.
Néanmoins, ce thème est plus que jamais d’actualité. Face à la responsabilité juridique de plus en grande de l’employeur en cas d’accident sur la place de travail, la tentation est grande au sein de nombreuses entreprises de passer par la mise en place de tests de dépistage. Or tout test va à l’encontre de la protection de la personnalité, sauf en cas de soupçon de consommation de drogues ou d’alcool et avec l’accord des personnes directement concernées. Néanmoins, si une entreprise souhaite dans un but préventif faire des tests pour certaines fonctions à risque, elle doit le spécifier dans une clause spécifique intégrée dans le contrat de travail.
Des tests préventifs de dépistage au travail ne peuvent pas être effectués à large échelle.
Plusieurs documents posent les bases en matière de sécurité et de protection de la personnalité :
- Le code des obligations dans son article sur la protection de la personnalité (art. 328 CO)
- La loi fédérale sur la protection des données (art. 3 à 17 LPD, mais notamment l’art. 6 définissant le principe de proportionnalité)
- La loi sur le travail (LTr)
- Les ordonnances de Conseil fédéral concernant le secteur public
Différents avis de droit mentionnent que des tests de dépistage préventifs sur la place de travail ne pouvaient pas être effectués à large échelle, mais seulement en cas de soupçon de consommation de substances psychoactive et avec l’accord des personnes concernées. Pour des groupes professionnels à risque, des tests préventifs peuvent être à titre exceptionnel demandés. Cette mesure doit être alors expressément prévue dans une clause du contrat de travail.
Par mesure de sécurité, si une entreprise souhaite faire des tests préventifs pour certaines fonctions à risque, elle doit le spécifier dans une clause spécifique intégrée dans le contrat de travail.
La confidentialité du résultat de ces tests doit être strictement respectée. Tenue de respecter le secret médical, la personne issue du monde médical ayant fait passer le test ne peut livrer qu’un seul verdict : aptitude ou inaptitude à poursuivre le travail.
La protection des données est un aspect spécifique de la protection de la personnalité. Par données personnelles, on entend tous les renseignements, indications ou notes, y compris les dossiers de candidature, concernant la personne du travailleur ou de la travailleuse et qui portent tant sur sa vie privée que professionnelle. Cette notion recouvre toutes les données recueillies tant par l’employeur lui-même que par un tiers auquel il aurait confié cette tâche. Tout ce qui touche à la sphère intime et à la santé est considéré comme une donnée sensible.
La matière est principalement régie par la Loi fédérale sur la protection des données (LPD). Dans les relations de travail, cette loi est complétée par l’art. 328b CO, selon lequel l’employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur ou la travailleuse que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes de la personne concernée à effectuer son emploi ou sont nécessaires à l’exécution du contrat de travail.
Les données sur les aptitudes de la personne employée incluent les diplômes, les anciens certificats de travail, ainsi que des informations courantes comme l’âge, l’adresse, l’état civil ou le numéro AVS, mais aussi, par exemple, des allergies à certains produits.
Les informations nécessaires pour exécuter le contrat de travail sont surtout celles dont l’employeur a besoin pour respecter ses obligations légales ou contractuelles, comme les évaluations, les formations suivies, les absences ou encore les lettres d’avertissement ou de promotion.
En Suisse, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence a estimé que des tests pratiqués systématiquement sur toute une catégorie d’employés et d’employées étaient disproportionnés et qu’un dépistage préventif ne pouvait se justifier que pour les métiers à risque. Des tests invasifs (analyses d’urine, de salive, de sueur, de cheveux et d’ongles) ne sont admissibles qu’en cas de soupçon. C’est le cas si l’on constate qu’un employé ou qu’une employée n’est pas en mesure d’exécuter correctement sa tâche de travail. Les tests non-invasifs (alcootest) et non fondés sur un soupçon sont autorisés à titre préventif.
Néanmoins, si une entreprise souhaite dans un but préventif faire des tests pour certaines fonctions à risque (ex. chauffeur·euse·s professionnel·le·s, conducteur·rice·s de machine, grutier·ère·s, pilotes), elle doit le spécifier dans une clause spécifique intégrée dans le contrat de travail.
Par ailleurs, la confidentialité du résultat de ces tests doit être strictement respectée. L’employeur n’a pas à connaître le résultat de ces tests. Tenu de respecter le secret médical, seul le ou la médecin du travail, le ou la médecin conseil voire le ou la médecin traitant-e ou toute personne étant habilitée à faire de telles investigations, peut livrer un verdict : aptitude ou inaptitude à poursuivre le travail. Sans autres détails.
Seul le patient ou la patiente peut permettre au ou à la médecin de lever le secret médical. Pour être valable, le consentement doit être donné librement, sans pression aucune, et être évalué selon le principe de proportionnalité. Cela signifie que le secret ne peut être levé que pour certaines informations utiles pour atteindre les objectifs en vue desquels le consentement a été donné.
Au sens large, le secret médical se comprend comme un devoir de confidentialité auquel est tenu tout le personnel soignant, voire d’autres acteurs du domaine de la santé. Au sens strict, le secret médical est l’obligation spécifique de discrétion pesant notamment sur les membres de diverses professions de la santé (médecins, dentistes, pharmaciens, sage-femmes) et leurs auxiliaires, en vertu de l’art. 321 al. 1 CP.
Le consentement de la personne concernée constitue généralement le principal fondement juridique au traitement, et en particulier à la communication de données personnelles (art. 6 al. 6 LPD). Il permet aussi de lever le secret professionnel (art. 321 al. 2 CP). Pour être valable le consentement doit être donné librement et ne pas constituer un engagement excessif au sens de l’art. 27 al. 2 CC. Dans chaque cas d’espèce, la portée du consentement doit être évaluée selon le principe de proportionnalité : cela signifie que le consentement ne légitime que la révélation des informations qu’il est nécessaire de communiquer au tiers pour atteindre l’objectif en vue duquel le consentement a été donné.
En principe, le consentement, donné par le patient ou la patiente à la communication d’informations à un tiers, ne peut porter que sur les faits dont il ou elle avait connaissance. Le consentement devrait également être limité à un objet déterminé. Un patient ou une patiente, qui permettrait la révélation de secrets pour le présent et l’avenir et dont le consentement irait si loin qu’il impliquerait une renonciation totale à l’intimité, agirait de ce fait contre les mœurs. Le droit à l’intimité relève du droit de la personnalité. Il est comme tel inaliénable.
En matière de relations de travail, le consentement donné par le travailleur ou la travailleuse doit certainement être évalué à l’aide de critères particulièrement sévères, étant donné qu’une dépendance économique et juridique de la personne employée vis-à-vis de son employeur existe. Selon la doctrine majoritaire, le consentement du travailleur ou de la travailleuse n’autoriserait d’ailleurs pas l’employeur à aller au-delà de ce que permet l’art. 328b CO, en raison de son caractère relativement impératif, c’est-à-dire que l’on peut y déroger qu’en faveur du travailleur ou de la travailleuse (cf. art. 362 CO).
Il ressort clairement de ces différentes sources qu’il faut un risque réel pour qu’un employeur puisse se livrer à des dépistages systématiques. Les différents articles de loi insistent sur la proportionnalité entre le danger réel et l’atteinte à la personnalité du travailleur et vont tous dans un sens extrêmement restrictif des contrôles sur le lieu de travail.
Réduction des prestations
Lors d’un accident d’un véhicule ou d’une machine, la personne sous l’effet de substances psychoactives pendant l’exercice de son service, risque une réduction de ses prestations en espèces, pour autant qu’il y ait un lien de causalité entre la prise de substances et l’accident.
La législation sur la prévention des accidents fait une distinction entre les accidents professionnels et les accidents non professionnels. S’agissant d’un accident de travail, même dû à la prise de substances (négligence grave selon l’art. 37 al.2 LAA), la couverture de l’assurance est garantie, sauf si l’on a pu constater un délit. Selon l’art. 21 al. 1 LPGA ,«Si l’assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées».
Lorsque l’état de fait porte sur la conduite d’un véhicule ou d’une machine sous l’effet de substances psychoactives pendant l’exécution du service, une réduction des prestations en espèces est envisageable (indemnités journalières ou rentes), pour autant qu’il y ait un lien de causalité entre la consommation de substances et l’accident. Les frais de traitement ne sont pas concernés (art. 37 al.3 LAA).
En ce qui concerne les accidents non professionnels survenus sous l’effet d’une substance, la personnes assurée encourt la perte totale ou partielle de la couverture, même s’il n’y a pas eu de délit. Une négligence grave ou un acte qualifié d’entreprise téméraire suffisent déjà à l’application d’une telle décision. Selon l’art. 50 de l’OLAA (Ordonnance sur l’assurance-accidents), on parle d’entreprise téméraire lorsque «l’assuré s’expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures». Une consommation d’alcool inappropriée et excessive peut correspondre à cette définition et par là même entraîner une non-entrée en matière pour des prestations en espèces.
Licenciement
On ne peut pas licencier une personne parce qu’elle est en situation d’addiction, mais on peut le faire si ses prestations professionnelles sont insuffisantes.
Le licenciement d’une personne vivant des difficultés liées à la consommation de substances pose des questions délicates. La licéité d’un tel licenciement dépend des circonstances précises du cas d’espèce. Les mots choisis sont déterminants.
Devrait être qualifié d’abusif un licenciement motivé par la formulation « parce que vous êtes en situation d’addiction » (ou de façon stigmatisante : «parce que vous êtes toxicomane» ou «drogué»). Par contre un congé n’est pas considéré comme abusif si le motif est « parce que votre prestation de travail est nettement insuffisante ». Lorsque la personne concernée est en congé-maladie, elle bénéficie en principe d’une période de protection empêchant ou reportant les effets de la résiliation du contrat de travail. Enfin, dans certains cas, le devoir incombant à l’employeur de protéger la personnalité et la santé des personnes employées par l’entreprise (art. 328 CO) peut impliquer l’obligation de résilier le contrat de travail de la personne concernée en particulier. C’est notamment le cas lorsque la personnalité ou la santé des collègues est mise en danger.
Le droit suisse des contrats permet aux parties concernées (employeur et personne employée), de résilier un contrat de travail sans motifs, sous réserve du respect de délais et termes prévus dans la loi.
Le droit suisse des contrats est basé sur le principe de la liberté contractuelle. Les parties ont ainsi le droit de résilier librement le contrat de travail et sans motifs, sous réserve du respect des délais et termes prévus dans la loi. En cela notre législation se distingue des droits de la plupart des Etats européens, liés par la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail, dans lesquels la résiliation du contrat de travail doit obligatoirement être fondée sur un motif légitime, lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou de la travailleuse, ou encore sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise.
Certes, «la partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande» (art. 335 al. 2 CO), mais une violation de l’obligation de motiver le congé est toutefois sans effets sur la validité de celui-ci. En effet, les rapports de travail prennent fin au terme du délai de congé, même si l’employeur refuse de communiquer, par écrit, les motifs à la personne concernée. Un tel refus pourra toutefois être sanctionné de manière indirecte, dans le procès éventuel portant sur la protection contre le congé, sur le plan de l’appréciation des preuves ou de la répartition des frais de justice. L’obligation de motivation a pour but premier de permettre à la partie dont le contrat a été résilié de vérifier la motivation de la résiliation.
Le congé est abusif lorsqu’il est donné par une partie pour une raison inhérente à la personnalité de l’autre partie (sexe, statut familial, origine, race, nationalité, orientation sexuelle, âge, antécédents judiciaires, séropositivité, maladie ou handicap), à moins que cette raison n’ait un lien avec le rapport de travail en diminuant par exemple les prestations professionnelles de la personne concernée.
Tout droit peut être exercé de manière abusive (cf. art. 2 al. 2 CC). Il en va ainsi également en matière de licenciement : dans certains cas, un congé sera considéré comme abusif. Cette question est réglée aux art. 336 ss CO. On considère que ce n’est pas le but du congé (mettre fin à la relation contractuelle) qui est illicite, mais le motif intérieur qui a poussé de manière décisive l’une des parties à résilier le contrat.
Il faut toutefois préciser que le caractère abusif d’un congé n’affecte pas sa validité. En revanche, la victime d’un tel congé a en principe droit à une indemnité dont le montant est fixé par le juge, mais qui correspond au maximum à six mois de salaire (art. 336a CO). L’art. 336 CO énonce huit cas de congés abusifs qui ne sont d’ailleurs pas exhaustifs. Plus particulièrement, c’est l’art. 336 al. 1 let. a, sur le congé dit «discriminatoire», qui est le plus pertinent. Selon cette disposition, le congé est abusif lorsqu’il est donné par une partie pour une raison inhérente à la personnalité de l’autre partie, à moins que cette raison n’ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l’entreprise (motifs justificatifs).
Raison inhérente à la personnalité
Sont considérées comme des raisons inhérentes à la personnalité l’ensemble des caractéristiques d’une personne dignes d’être protégées par la loi, notamment le sexe, le statut familial, l’origine, la race, la nationalité, l’orientation sexuelle, l’âge, les antécédents judiciaires, ainsi que la séropositivité, la maladie ou un handicap.
Le Tribunal fédéral a expressément admis que la maladie était une qualité propre à la personne au sens de l’art. 336 al. 1 let. a CO
(TF 4C.174/2004 du 5 août 2004, c. 2.2.2). Le fait de vivre des difficultés liées à la consommation de substances est certainement une caractéristique de la personnalité du travailleur, que l’on considère le problème comme une maladie ou comme une habitude ou une préférence de consommation. Ainsi, un licenciement fondé exclusivement sur cette caractéristique pourrait être considéré comme abusif au sens de la disposition précitée.
Possibilité d’invoquer un motif justificatif
L’employeur peut cependant fonder le congé sur un motif justificatif. En effet, il ne saurait en principe y avoir d’abus lorsque la raison justifiant le congé présente un lien avec le rapport de travail, en particulier avec l’obligation de travailler et le devoir de fidélité du travailleur (cf. TF 4C.174/2004 du 5 août 2004, c. 2.2.2). Un congé donné à un travailleur ou à une travailleuse qui, du fait de sa consommation, n’accomplit pas correctement sa prestation de travail n’est pas abusif. En effet, la raison du licenciement a un lien avec le rapport de travail. Être en situation d’addiction peut d’ailleurs également porter un préjudice grave au travail dans l’entreprise.
En revanche, la résiliation en raison d’une maladie latente, telle la séropositivité, est abusive si cette maladie n’a aucun lien avec le rapport de travail.
S’il veut invoquer ce motif justificatif, l’employeur doit prouver sa pertinence et ne pas être à l’origine de la situation qu’il invoque. Il est évident que le congé serait abusif si c’est l’employeur lui-même qui a incité le travailleur ou la travailleuse à consommer. On devrait considérer, de même, que l’employeur qui ne prend aucune mesure pour prévenir ou réduire la situation d’addiction est, en partie du moins, à l’origine de la situation qu’il invoque. En licenciant un travailleur ou une travailleuse en situation d’addiction, il se rendrait ainsi l’auteur d’un licenciement abusif au sens de l’art. 336 CO.
La loi protège le travailleur ou à la travailleuse contre la résiliation du contrat de travail en temps inopportun.
La résiliation du contrat notifiée pendant une période de protection est absolument nulle. L’employeur devra dans ce cas renouveler la résiliation après l’expiration du délai de protection.
L’art. 336c CO offre au travailleur ou à la travailleuse une protection contre la résiliation du contrat de travail par l’employeur en temps inopportun. L’employeur ne peut, par exemple, résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et 180 jours à partir de la sixième année de service.
La résiliation du contrat notifiée pendant une période de protection est absolument nulle. L’employeur devra dans ce cas renouveler la résiliation après l’expiration du délai de protection. En revanche, si le congé a été donné avant l’une des périodes de protection et que le délai de congé n’a pas expiré pendant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période. Le congé reste toutefois valable, de sorte que l’employeur n’aura pas à le renouveler.
C’est au travailleur ou à la travailleuse qu’il appartient d’apporter la preuve de son empêchement de travailler pour cause de maladie. Pour ce faire, il ou elle aura le plus souvent recours à un certificat médical qui ne doit pas décrire l’atteinte à la santé, couverte par le secret médical, mais attester de l’incapacité de travail en précisant son taux et sa durée et indiquer s’il s’agit d’une maladie ou d’un accident.
Selon le texte légal, l’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident doit être non fautive. L’interprétation de la faute doit toutefois être restrictive, de sorte que seule une faute grave du travailleur ou de la travailleuse devrait permettre l’exclusion de la protection octroyée par la loi. Selon certains avis, la question de la faute ne devrait se poser que dans les cas très rares où la personne concernée aggrave intentionnellement son état, notamment en https://www.addiction-et-monde-du-travail.ch/comprendre/bases-legales/refusant de se soumettre à un traitement médical. La dépendance (qui est un état diagnostiqué par un ou une spécialiste de la santé) étant reconnue comme une maladie, l’incapacité de travail causée par son traitement ne saurait être fautive.
Même si la dépendance est une maladie, l’employeur pourrait être tenu de résilier le contrat de travail de la personne concernée si celle-ci, malgré un ou plusieurs avertissements, ne modifie pas ses comportements et continue à mettre en danger sa santé et celle de ses collègues.
L’employeur pourrait également être tenu de licencier le travailleur ou la travailleuse vivant des difficultés liées à sa consommation qui met en danger sa propre santé si cette mesure paraît justifiée pour éviter un danger important d’accident.
Selon l’art. 328 CO, l’employeur doit protéger la personnalité, la vie et la santé des personnes employées. L’employeur a non seulement l’obligation de s’abstenir personnellement de toute atteinte directe aux droits de ces dernières, mais il a également l’obligation d’entreprendre tout ce qui est nécessaire pour empêcher une telle atteinte. Il doit dès lors organiser le travail, définir les responsabilités et les tâches, donner les instructions nécessaires et surveiller que celles-ci soient respectées.
Cette obligation de protection lui impose de prendre les mesures adéquates si la personnalité ou la santé de l’un ou de plusieurs membres du personnel fait l’objet d’atteintes, notamment de la part d’autres membres du personnel.
On admet même que, lorsqu’un employé ou une employée porte sérieusement atteinte aux droits de la personnalité de l’un ou l’une de ses collègues de travail, par exemple en proférant des menaces à son encontre, les obligations découlant du contrat de travail sont gravement violées. Par conséquent, une résiliation immédiate au sens de l’art. 337 CO peut s’imposer.
Ainsi, dans le cas d’un travailleur ou d’une travailleuse étant sous les effets d’une substance, l’employeur est tenu d’évaluer si la personne concernée est apte à fournir sa prestation de travail dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Si tel n’est pas le cas, il devra le libérer de sa prestation de travail et lui demander de rentrer chez lui. Dans un cas d’espèce, l’employeur pourrait être tenu de résilier le contrat de travail d’une personne en situation d’addiction si celle-ci, malgré un ou plusieurs avertissements, ne modifie pas son attitude violente ou injurieuse envers des collègues de travail. Il en va de même évidemment si la personne concernée met en danger la santé de ses collègues.
L’employeur pourrait également être tenu de licencier la personne concernée qui met en danger sa propre santé si cette mesure paraît justifiée pour éviter un danger important d’accident.
Notons encore que lorsque les conditions d’application d’un congé immédiat au sens de l’art. 337 CO sont réunies, la résiliation est valable même si l’on se trouve durant une période de protection contre les congés en temps inopportun selon l’art. 336c CO.
Mesures d'accompagnement contractuel
Pour éviter la perte de son emploi à une personne en situation d’addiction, de nombreuses entreprises proposent dans un premier temps une convention de traitement.
La perte de son emploi pour un travailleur ou une travailleuse en situation d’addiction est une circonstance de nature à augmenter la marginalisation de la personne concernée et à réduire les chances d’un rétablissement. C’est pourquoi, afin d’éviter d’arriver à de telles extrémités, de nombreuses entreprises proposent dans un premier temps une convention de traitement à la personne concernée. Une suspension des mesures administratives est souvent proposée, lorsque la personne concernée s’engage à suivre un traitement, après que des faits objectifs aient été établis.
Même si les conventions de traitement n’ont que très peu de valeur juridique, elles engagent la personne concernée dans un processus de traitement. La contrepartie est une suspension des mesures administratives dont elle fait l’objet, établie après l’observation de faits objectifs.
Un tel accord de traitement n’est pas réglementé par la loi dans notre système juridique et doit donc être qualifié de contrat innommé. Il est signé d’une part par l’employé et d’autre part par l’employeur (par exemple, le supérieur hiérarchique direct ou la personne responsable du personnel). Selon la situation, cet accord peut également être rédigé et signé par le centre de traitement des addictions concerné. Dans ce cas, il s’agit d’un accord tripartite.
L’analyse juridique d’un tel accord s’avère difficile, car il n’est pas aisé de déterminer les droits et obligations des parties contractantes. En cas de litige entre les parties concernant l’interprétation ou l’application d’un tel accord, il serait en outre problématique de déterminer si c’est le tribunal du travail ou le tribunal ordinaire qui est compétent.
Sans doute, l’appréciation ne serait d’ailleurs pas la même suivant le lieu du tribunal saisi ou sa composition. Il est cependant tout à fait possible que sa licéité soit mise en doute dans la mesure où l’on considérerait qu’elle est contraire aux droits de la personnalité et qu’elle constitue un engagement excessif pour le travailleur ou la travailleuse.
Il faut rappeler que l’employeur a le devoir de protéger la personnalité du travailleur ou de la travailleuse (art. 328 al. 1 CO). Font partie de la personnalité tous les éléments propres à sa vie privée. Il est donc extrêmement délicat pour un employeur d’obliger un travailleur ou une travailleuse à un comportement déterminé en dehors de ses heures de travail. Relevons cependant, qu’à titre exceptionnel, lorsque l’employeur est considéré comme une «entreprise à tendance» (parti politique, syndicat, association religieuse), le devoir de fidélité des personnes employées est accru. Cela pourrait impliquer le droit pour l’employeur de donner des directives qui s’appliquent également en dehors des heures de travail.
Il est vrai que le travailleur ou la travailleuse peut très bien donner son accord à une telle convention. Il n’en demeure pas moins que la convention pourrait être considérée comme juridiquement nulle si l’accord de la personne concernée constitue un engagement excessif. L’art. 27 al. 2 CC protège la liberté personnelle ainsi que la liberté de décision à l’encontre des atteintes excessives et contraires aux mœurs.
La question centrale, dans un cas concret, n’est pas de déterminer si la personne concernée est touchée par une situation ou une maladie, mais bien de vérifier si elle est apte à travailler et si elle exécute correctement sa prestation de travail en fonction des critères susmentionnés.
Lorsque la situation de la personne concernée n’a pas de répercussion visible ou notable sur sa prestation de travail, l’employeur n’est pas en droit d’exiger une modification du comportement du travailleur ou de la travailleuse. Il ne pourrait pas, par exemple, convenir avec la personne concernée que celle-ci cesse sa consommation. Il existe le risque qu’une telle convention soit déclarée nulle de plein droit (cf. art. 20 al. 1 CO) si l’on considère que son contenu est contraire aux bonnes mœurs, la convention impliquant un engagement excessif du travailleur ou de la travailleuse (art. 27 al. 2 CC).
Lorsque la personne concernée n’exécute pas correctement sa prestation de travail du fait qu’elle est en situation d’addiction, la situation est sensiblement différente. Dans cette hypothèse, l’employeur est en droit de mettre la personne concernée en demeure de modifier son comportement. Selon l’intensité des manquements du de cette dernière, l’employeur a même le droit de résilier le contrat de travail avec effet immédiat, suivant les cas avec ou sans avertissement préalable (cf. art. 337 CO). Dans ce genre de situation, l’employeur pourrait aussi renoncer à une telle mesure et donner un délai à la personne concernée pour modifier son comportement.
C’est sans doute dans ce cadre qu’une convention de traitement s’inscrirait le mieux. La personne concernée s’engagerait alors à prendre les mesures nécessaires à l’amélioration de sa prestation de travail, alors que l’employeur s’engagerait à ne pas résilier le contrat de travail pendant une certaine durée (contrat de durée minimale).
Apéros, pots et fêtes
Il n’y a pas de responsabilité de l’employeur en cas d’accident, dû à une consommation inappropriée de substance (ex. alcool), survenu en dehors (ou à l’intérieur) de l’entreprise et des heures de travail.
L’employeur doit protéger la santé de ses employés et employées sur le lieu de travail. Il doit notamment garantir que le personnel puisse exécuter sa prestation de travail sans risque d’atteinte à sa santé et à sa personnalité.
Selon un avis de droit demandé à des juristes, il semble que l’employeur n’est en revanche pas responsable de la bonne santé de ses employés et employées en général. Il n’engage ainsi pas sa responsabilité pour un accident survenu en dehors de l’entreprise et des heures de travail, même si l’accident est dû à une consommation de substance effectuée sur le lieu de travail, car, dans ce genre de situation, la condition du lien de causalité manque dans la plupart des cas. La responsabilité de l’employeur ne sera en principe pas engagée non plus dans le cadre de l’assurance- accidents.
Trois raisons excluent la responsabilité de l’employeur lors des apéros, des pots et des soirées d’entreprises.
Les apéritifs, les soirées d’entreprise ou les consommations prises dans les restaurants d’entreprise présentent trois spécificités qui excluent à priori la responsabilité de l’employeur :
- Le danger à prévenir est difficile à quantifier dans la mesure où chaque personne ne boira pas la même quantité ou n’aura pas la même tolérance à l’absorption d’alcool. Par ailleurs, il est parfaitement possible de participer à un apéritif et d’y consommer de l’alcool sans qu’un accident se produise.
On ne peut pas attribuer à l’organisation de ces événements une responsabilité particulière de l’employeur liée au non-respect de l’obligation de protéger la santé et la personnalité du personnel. L’employeur pourrait même dire que ces moments festifs font partie d’une démarche positive pour renforcer les relations de travail, encourager l’esprit d’équipe et favoriser de bonnes relations entre les membres du personnel.
- Le travailleur ou la travailleuse n’est, dans la plupart des cas, pas dans l’obligation de consommer de l’alcool dans le contexte professionnel : apéritif d’entreprise, soirée du personnel ou encore dans au restaurant de l’entreprise. Une personne, lorsqu’elle peut se déterminer librement, est donc en mesure de consentir à une éventuelle atteinte à sa santé.
- Le plus souvent, les conséquences ou les risques d’accident ne se produiront pas sur le lieu de travail. Le cas sera donc analysé comme un accident non-professionnel dont l’employeur n’a pas à répondre.
Les accidents, notamment de la circulation, survenant après une manifestation organisée dans le cadre de l’entreprise, avec ou sans alcool, sont en principe des accidents non professionnels. Une consommation exagérée et inappropriée d’alcool engage la seule responsabilité de l’assuré ou de l’assurée.
La réglementation relative à la réduction et au refus de prestations n’est pas uniforme. En cas d’accidents professionnels, la réduction des prestations est limitée à la faute intentionnelle. En cas d’accidents non professionnels, en revanche, les prestations sont également réduites si l’assuré ou l’assurée a commis une faute grave non intentionnelle. Les accidents (notamment les accidents de la circulation) survenant après une manifestation organisée dans le cadre de l’entreprise, avec consommation de boissons alcoolisées, sont en principe des accidents non professionnels.
Une éventuelle responsabilité de l’employeur ne peut, en principe, être envisagée dans le cadre de l’assurance-accidents. Une consommation exagérée – et occasionnelle – de boissons alcoolisées engage la seule responsabilité de l’assuré ou de l’assurée.
S’agissant d’accidents non professionnels survenus sous l’effet de l’alcool, la responsabilité de la personne assurée est donc entière et les réductions de prestations prévues dans les dispositions fédérales (LAA / LCR notamment) peuvent être appliquées.
La notion d’accident professionnel est interprétée de manière restrictive lorsqu’un accident survient au cours d’activités ou de manifestation organisées par l’entreprise.
A la teneur de l’art. 7 al. 1 LAA, sont réputés accidents professionnels « les accidents (art. 4 al. 1 LPGA) dont est victime l’assuré dans les cas suivants :
- Lorsqu’il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt ;
- Au cours d’une interruption de travail, de même qu’avant ou après le travail, lorsqu’il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle.
Les différents éléments de cette définition ont donné lieu à des précisions de la part des assureurs chargés de leur application. Ainsi, le « lieu de travail » est délimité par la clôture de l’entreprise. Les routes et chemins d’accès (publics) ne sont pas assimilés au lieu de travail. Par ailleurs, les laps de temps précédant et suivant le travail, ainsi que les interruptions de travail entrent dans la sphère professionnelle pour autant que la personne assurée reste sur les lieux. Si le travailleur ou la travailleuse quitte les lieux, l’accident qui surviendra sera, alors, un accident non professionnel.
L’art. 12 de OLAA (Ordonnance sur l’assurance-accidents) donne des précisions utiles en ce qui concerne des situations particulières, notamment les sorties d’entreprises. A la teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, « sont notamment réputés professionnels au sens de l’art. 7 al. 1 de la loi les accidents subis :
- Pendant un voyage d’affaire ou de service, soit dès l’instant où l’assuré quitte son domicile et jusqu’au moment où il le réintègre, à moins que l’accident ne se produise durant les loisirs ;
- Pendant une sortie d’entreprise organisée ou financée par l’employeur ;
- Lors de la fréquentation d’une école ou d’un cours prévue par la loi ou un contrat ou autorisée par l’employeur, à moins que l’accident ne se produise durant les loisirs ;
- Pendant les trajets effectués par les assurés dans des véhicules de l’entreprise pour se rendre au travail ou en revenir, si le transport est organisé et financé par l’employeur.
S’agissant plus spécifiquement des sorties d’entreprise, les assureurs admettent l’existence d’un accident professionnel lorsque, pour la sortie en question, les conditions suivantes sont toutes ou en partie réalisées : la sortie
- A lieu un jour de travail rémunéré
- Doit être plus ou moins obligatoirement fréquentée par les membres de l’entreprise ;
- Est organisée ou partiellement payée par l’entreprise.
Source : Recommandations de la Commission ad hoc Sinistres LAA
En revanche, les accidents qui surviennent au cours d’activités de loisirs comme les journées de ski, les tournois de football, les excursions en montagne, par exemple, n’entrent pas dans la catégorie des accidents professionnels.
Il découle, de cette première analyse, que la notion d’accident professionnel est interprétée de manière restrictive lorsque l’accident survient au cours d’activités ou de manifestations organisées par l’entreprise.
A la teneur de l’art. 8 al. 1 LAA, sont réputés accidents non professionnels «tous les accidents (art. 4 LPGA) qui ne sont pas des accidents professionnels». Les personnes occupées à temps partiel sont également assurées contre les accidents non professionnels à condition qu’elles soient occupées, chez un employeur, au moins huit heures par semaine (art. 13 al. 1 OLAA). Pour les personnes à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail n’atteint pas ce minimum d’heures, «les accidents subis pendant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail sont réputés accidents professionnels» (art. 13 al. 2 OLAA).